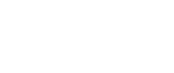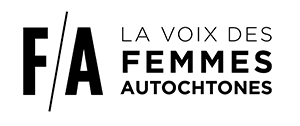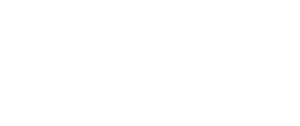Pour célébrer les 20 ans de deux résolutions permettant la reconnaissance du viol comme crime de guerre, l’ONU Femme France organise un forum digital sur le thème “Une paix durable sans les femmes est-elle possible ?”, le 15 octobre 2020 à 18h30. Deux tables rondes sont prévues, dont une portant spécifiquement sur les violences sexuelles lors des conflits. Car malgré ces résolutions, “le viol comme outil de guerre est devenu endémique et quasi-systématique”, note sur son site internet We are not weapons of war, une ONG militant pour la sensibilisation et l’élimination des violences sexuelles lors d’affrontements. Aujourd’hui encore, elles sont utilisées en République Démocratique du Congo, en Irak contre les Yézidis et en Birmanie contre les Rohingyas, et restent un outil à part entière pour traumatiser et détruire les populations.
Une stratégie militaire à part entière
Il n’existe pas de données précises concernant les violences sexuelles en temps de guerre dans le monde : elles sont rarement reconnues voire seulement signalées. Quant aux estimations généralement données dans le monde, We are not weapon of war conseille de les “multiplier par 3 voire 5 fois pour correspondre à la réalité”. “Les violences sexuelles dans les conflits sont une stratégie militaire ou politique à part entière”, continue l’ONG. “Elles sont définies et décidées en haut lieu au même titre qu’est décidé le bombardement d’un village, l’extermination d’un peuple, le gazage d’une communauté”. Un “crime parfait”, rarement puni, aux victimes invisibilisées. Il sert à la fois à humilier et intimider des populations, à détruire des communautés, à empêcher les femmes d’enfanter, et même à transmettre délibérément des maladies comme le VIH.
Lors du génocide qui a déchiré le Rwanda en 1994, entre 250 000 et 500 000 femmes ont été abusées sexuellement le temps d’un printemps, selon l’ONU. Le viol était même encouragé par les médias. “Les femmes tutsies ont connu des barbaries extrêmes”, déplore Victoire. Elle avait 32 ans lors du génocide. Les femmes tutsies étaient considérés selon l’idéologie raciste hutue comme étant des espionnes ou lascives, et étaient souvent tuées après avoir servi d’esclaves sexuelles. “Même après avoir été violée, les miliciens enfonçaient des bâtons dans leur vagin ou avec des piquets de bois puis elles étaient abandonnées sur les collines quand elles n’étaient pas tuées”, narre Victoire. “La femme tutsie était d’abord traînée dans la brousse puis violée et tuée dans des conditions atroces”. Elle se souvient : “On m’a enterrée vivante et une fois, ils m’ont fait boire une bouteille de Thiodan, un pesticide qu’on utilise pour tuer les insectes. Mais j’ai survécu”.
Le viol est d’autant plus une arme pernicieuse qu’elle touche les victimes au plus profond d’elles-mêmes, laissant des traumatismes invisibles qui peuvent ne jamais s’effacer. “C’est un combat éternel parce que le viol laisse des blessures, ne finit pas, continue à revenir et tue le cerveau, le coeur et l’âme. Il blesse le corps mais n’épargne pas non plus l’esprit”, affirme Victoire, “donc il faut à tout prix le combattre et sortir de cet état”. Au Rwanda, après le génocide, les survivantes se sont organisées et entraidées. Certaines, comme Victoire, ont témoigné devant les tribunaux traditionnels. “Il faut beaucoup de courage pour oser dire que tu as été victime du viol et en parler publiquement”, assure-t-elle. Par l’action des survivantes rwandaises, le viol comme crime de génocide a été inscrit dans la loi rwandaise. A ce jour, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda est le premier – et le seul – tribunal international à l’avoir reconnu.
Mais “celles qui se sont tues, qui l’ont gardé dans leurs cœurs, souffrent en silence. Ces victimes sont devenues malades ou handicapées mentales”. Victoire à son tour soutient les femmes survivantes dans le cadre d’atelier de parole et prévient les autorités dès que l’une d’entre elles est en faiblesse.
La prévention est la clef pour lutter contre ces sévices et les traumatismes qui en découlent. “Une victime sur trois tente de se suicider dans les 72h suivant le viol par manque d’accès aux soins”, alerte We are not weapons of war. Pour leur porter assistance et recueillir des données fiables, l’ONG développe une application mobile. Nommée BackUp, elle permettrait aux victimes de violences sexuelles en temps de guerre de se signaler et aux professionnels de coordonner leurs actions. L’organisation veut changer d’angle d’approche : ”il ne faut pas demander aux victimes de se rendre vers les services, mais il faut apporter les services à ces victimes”.
Marion Fontaine
Pour plus d’information, rejoignez ici le forum digital de l’ONU sur « Une paix durable sans les femmes est-elle possible ? ».