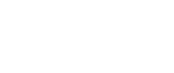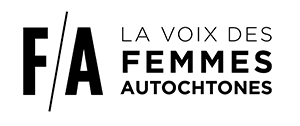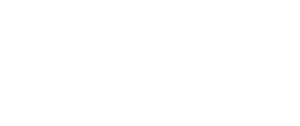L’Équateur est le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature, en 2008, dans sa constitution, alors même que 40 % de son PIB et près de 60 % de ses exportations proviennent des hydrocarbures, principalement situés en Amazonie .
Mais “Exploiter tout en préservant” semble être la devise de ce gouvernement qui, en Juillet 2018, a lancé un plan de bioéconomie durable.
Le même mois, les indiens kichwas de Sarayaku déposaient à Quito la déclaration de la Selva vivante et demandaient son inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco. Selon leur cosmogonie, la terre, le cosmos, les êtres humains, les animaux, la flore, les pierres, les montagnes, les lacs, forment un tout. Dans ce tout, il y aussi les êtres vivants de la forêt qui sont invisibles. C’est pourquoi la forêt doit être protégée, au même titre que les êtres humains.
Cette proposition est le fruit d’une longue histoire de résistance ou de lutte.
Dès 1992, ces 1.200 indiens se sont levés pour arracher leurs droits à la terre, soit 135.000 hectares de forêt primaire. Mais en 1996, le gouvernement accorde une concession d’exploitation pétrolière à la compagnie argentine CGC sur le territoire de Sarayaku. Ce peuple de chasseurs, pêcheurs et agriculteurs entre alors en résistance. Et en 2012, la Cour Interaméricaine des droits humains condamne l’État équatorien à leur verser 1, 4 millions de dollars pour non-respect du droit à la consultation préalable, en cas d’exploitation pétrolière. Une victoire sans précédent.
Aujourd’hui, les Sarayakus se consacrent à promouvoir le Sumak Kawsay, le bien-vivre en harmonie. Cette philosophie de vie guide la communauté et a valeur d’exemple dans le monde. Ils entendent aussi proposer une alternative pour réduire les conséquences du réchauffement climatique.
Une philosophie de vie à découvrir en compagnie d’Antonio Ran, responsable du “grand chemin vivant de fleurs” et du jardin botanique, qui travaille avec Patricia Gualinga, ambassadrice des droits de la nature.