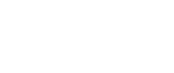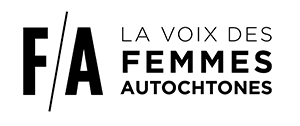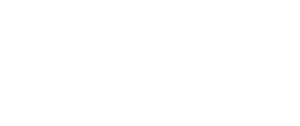En Guyane française, 3.000 Amérindiens de la forêt amazonienne ont le malheur de vivre sur un territoire convoité pour ses ressources minérales. Ils sont victimes de l’orpaillage illégal, ce qui crée un climat de violence et d’insécurité. De plus, en devenant français en 1969, les Amérindiens ont perdu leur mode de vie traditionnel et leur savoir. Ils font face à une double culture qu’ils n’ont pas choisie. Le mal-être est profond et les Amérindiens rêvent d’une identité propre tout en étant Français .
Avec l’arrivée du Covid 19, ils ont dû s’organiser et inventer des alternatives car cette population est encore plus vulnérable comme l’a rappelé l’ONU dans un communiqué.
A l’origine de ces initiatives, souvent des femmes que vous allez découvrir .
Des initiatives de protection
Des villages amérindiens du littoral se sont déjà volontairement isolés. Car « on sait que la prévention est notre alliée, mais les règles de distanciation par exemple c’est difficile pour nous, car on n’a pas cette habitude de vie. On est très proches de nos anciens, on vit avec eux, et c’est d’ailleurs pour eux qu’on a peur car ils sont plus fragiles », commente Claudette Labonté, militante amérindienne en faveur d’un rapprochement des services de l’État et des autochtones pour « l’élaboration de protocoles officiels adaptés au mode coutumier ». Alors des barrières ont été installées devant les villages comme à Sainte Rose.
Le repli sur la pêche et la chasse
La pêche, comme la chasse, est la solution de repli des habitants du Haut-Maroni pour compléter leurs provisions. « On fait les courses pour la moitié du mois, et pour le reste on se débrouille. On pêche et on chasse davantage », témoigne Anawaïke Pinkali, de Talhuwen. Pour nourrir sa famille, le jeune Wayana dépense environ 450 euros par mois. Selon ses calculs, il devrait en dépenser 600 ce mois-ci. Reste alors l’abattis (culture vivrière sur brûlis) pour compléter l’assiette. Mais cela ne suffit pas, d’autant plus que certains redoutent que les orpailleurs clandestins de la région, dont l’activité illégale s’est intensifiée depuis le début de la crise sanitaire, ne viennent piller ces cultures.
les Kali’nas du littoral au secours des amérindiens de l’intérieur
À Cayenne, Milca Sommer-Simonet enchaîne les après-midi au supermarché. « Les Wayana ont besoin de nourriture », affirme-t-elle. L’Onag a donc décidé de mobiliser son partenaire américain, le Suriname Indigenous Health Fund (SIHF), afin d’organiser un ravitaillement dans le Haut-Maroni. Selon leurs calculs, plus de 1 000 familles y vivent, le budget pourrait donc atteindre 10 000 euros. « Ce qui pourrait bloquer, ce serait le transport. Mais je vais toquer à toutes les portes s’il le faut », déclare la Kali’na.
Des cagnottes
La fédération Lokono présidée par Solange Biswana a également décidé de lancer une cagnotte afin de fournir des denrées de première nécessité aux différents villages amérindiens. La Croix-Rouge aussi se mobilise, et pas que pour les autochtones. « Les besoins sont criants, et ça risque de continuer après le confinement, rappelle un responsable de l’antenne locale. Toutes nos activités explosent. Ce n’est pas seulement lié à la crise, cette situation révèle des difficultés structurelles en Guyane. »
La pépite : l’antidote
« Ecrire en temps de confinement » c’était le thème d’un concours littéraire lancé par l’Académie de Guyane en début du mois d’avril. Au total une soixantaine de textes ont été compilés et publiés sur le site de l’Harmattan. Le texte de José du collège Gran Man Difou propose un antidote au virus. Drôle, poétique et puissant c’est le message d’un enfant de Maripasoula : un territoire grand comme deux fois la Corse et très isolé, au cœur de l’Amazonie française.
Merci aux amérindiens de nous faire partager leurs initiatives, à l’enquête de Julien Sarte et au journal Politis.
Anne Pastor